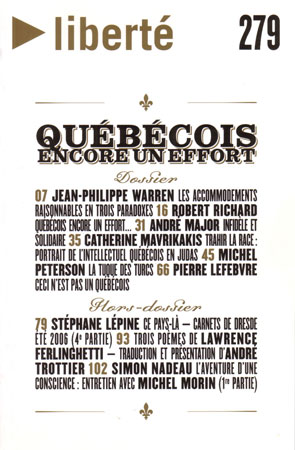
L’aventure d’une conscience :
1re partie, no 279
Version d'impression (PDF)
Simon Nadeau, (1re partie) no 279, février 2008, p. 102-115 et (2e partie) no 280, avril 2008, p. 73-84.
Présentation
De Michel Morin, on pourrait dire ce que Kierkegaard écrit à propos du penseur subjectif : « La forme du penseur subjectif, la forme de son message est son style. » La lecture des livres de Michel Morin nous révèle une pensée qui se fait, qui pointe vers l’idée et le concept (en cela l’auteur tient du philosophe), mais qui ne s’y fixe pas, préférant l’aventure de la pensée à la rigidité des systèmes philosophiques. Le savoir dont il est question dans les livres de Morin n’est pas d’abord un savoir abstrait ou théorique : c’est un « savoir transformateur » (Le contrat d’inversion), un savoir encore tout palpitant de l’« aventure intérieure » (Désert), qui plonge ses racines dans l’« expérience sensible » (Le murmure signifiant) : en cela l’auteur tient aussi de l’artiste. L’œuvre de Michel Morin témoigne de la nécessité de lier la vie (l’expérience existentielle), l’art (dans son cas l’écriture) et la philosophie (l’effort de la pensée). Voilà pourquoi on pourrait aussi le qualifier d’« artiste-philosophe », selon une expression forgée par Nietzsche.
Michel Morin poursuit depuis maintenant 30 ans son chemin de pensée. Depuis 30 ans, sa vie et sa pensée sont en jeu dans son écriture. Le tout a commencé avec la publication du Contrat d’inversion (1977, en collaboration avec Claude Bertrand) — véritable anti-contrat qui visait ni plus ni moins à renverser toutes les représentations sociales établies, que se soit la famille, le couple, la nation, les idéologies. Le parcours s’est poursuivi avec Le territoire imaginaire de la culture (1979, en collaboration avec Claude Bertrand) qui allait permettre aux auteurs de se penser et de se produire dans un espace culturel dénationalisé : l’Amérique, — d’où le titre suivant, L’Amérique du Nord et la culture (1982). Parmi les 13 ouvrages de Michel Morin publiés jusqu’à ce jour, certains abordent plus directement le rapport au politique, c’est le cas du Territoire imaginaire de la culture, d’autres mêlent l’intime au théorique comme Le contrat d’inversion ; certains explorent plus directement la condition de l’homme moderne dans le cadre de la civilisation technique et productiviste, c’est le cas du Murmure signifiant (2007) et de Désert(1988), d’autres enfin abordent des thèmes plus proprement philosophiques comme L’étrangeté de la raison(1993). Dans tous les cas cependant, quel que soit le livre, le destin non seulement de la pensée mais de son auteur se trouve en jeu. Le sujet, le sujet qui pense et qui s’adresse à quelqu’un d’autre, n’est jamais loin, il surgit alors qu’on ne s’y attendait plus, au détour d’un développement théorique il dit « je », il défaille et appelle son prochain.
En janvier 2007, les éditions Les Herbes rouges publiaient le treizième ouvrage de Michel Morin, Le murmure signifiant, accompagné d’une réédition en format poche de Désert. Dans Le murmure signifiant, l’auteur nous amène à porter notre attention du côté de ce qui nous échappe, le versant intérieur de l’expérience sensible. Il interroge à cette fin l’art moderne et le cinéma, d’une part, notre rapport aux moyens techniques et au monde du spectacle, d’autre part. Pour que ce « murmure signifiant » qu’évoque le titre de l’ouvrage puisse se faire entendre, l’auteur aura pris soin de déboulonner tout au long de son essai ce qu’on pourrait appeler l’idéologie moderniste et techniciste propre aux sociétés occidentales contemporaines. Quant à Désert, il remet en question de façon décisive la place de l’« objet » dans notre civilisation et ses corollaires : le monde des choses, le projet, l’objectivité. Remettre en question : c’est-à-dire viser l’au-delà de ce monde des choses, sans pour autant nier qu’il faille passer par l’objet, l’objectivation du monde, le travail, pour s’en libérer. Le dépouillement qui en résulte, par-delà le monde-objet, ouvre dans ce livre sur le don de soi, la parole, l’effusion, voire la communion. Qu’en est-il de la puissance imaginante et perceptive de l’individu et de sa liberté concrète, intérieure, dans le monde moderne ? Voilà une question qu’on aurait tort d’éviter. Lire Le murmure signifiant, c’est plonger au cœur de cette question !
I. L’écriture philosophique : un engendrement de soi par soi, une aventure de la conscience, un combat idéel
Simon Nadeau — J’aimerais, dans un premier temps, vous interroger sur votre conception de l’écriture philosophique. Par exemple, dans Le murmure signifiant, vous écrivez ceci :
La philosophie est un art abstrait, l’art même de l’abstraction… aussi est-il impératif que l’on sente, que l’on éprouve la douleur de ce travail à même le sensible — qui fait gémir et crier le sensible. On doit pouvoir entendre ce qu’il reste de gémissement dans l’idée, comme c’est le cas chez Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Cioran. Que vaut une idée qui ne m’a rien coûté ? Que je serais parvenu à vider de sa résonance interne ? (Michel Morin. Le murmure signifiant, Montréal, Les Herbes rouges, 2006, p. 183.)
Pourquoi, selon, vous, doit-on sentir le travail de l’idée à même le sensible, à même l’écriture ?
Michel Morin — Cette question va directement au cœur de mon travail et de la manière même dont je le comprends et l’effectue. L’écriture répond d’abord pour moi à un mouvement intérieur, une nécessité intérieure, lesquels sont indissociables de tout un réseau d’émotions qui les rendent possibles. De ce point de vue, ce qui donne lieu à l’écriture, telle que je la pratique, est très semblable à ce qui donnera lieu à une oeuvre d’art, qu’il s’agisse d’un poème, d’une peinture, voire d’une musique, mais le plus étonnant est que, écrivant à partir de cette nécessité intérieure, mon écriture s’exprime toujours d’une façon réflexive, c’est-à-dire méditative, et tende vers l’idée, tende à se rassembler autour d’idées et de concepts, à se développer de façon « théorique », même si la motivation première de cette écriture n’est jamais théorique. Il m’arrive dans ce que j’écris de faire état de telle ou telle situation existentielle particulière, mais cela reste marginal (mis à part certains livres), ma méthode consistant toujours à passer par-dessus le récit de ce qui est ressenti pour aller vers l’essentiel — ce qui me paraît être l’essentiel —, un peu comme si le besoin premier auquel je répondais était un besoin d’essentialisation, d’épuration, celui de dégager (de l’intérieur d’une situation émotive, par exemple, ou d’un état intérieur) ce qui est absolument irréductible, irréductibilité qui ne tient pas purement aux circonstances mais qui tient à ce qu’un sens cherche à s’exprimer à travers ces circonstances, besoin, donc, de dégager cet irréductible pour le livrer éventuellement à des lecteurs en présupposant que cet irréductible soit pertinent pour quiconque entre en relation avec lui. Sans doute perd-on un peu de la situation émotive, existentielle, qui donne lieu à cette généralité, mais c’est là justement que mon écriture se distingue d’une écriture fictionnelle, purement littéraire, ou d’une sorte de journal intérieur.
Qu’en est-il de cette souffrance que la citation dans votre question évoquait et que le lecteur devrait sentir à la lecture qu’il fait d’un écrit philosophique, ou d’un écrit réflexif? Je pense que cette souffrance, ce n’est rien d’autre que celle qui consiste à sacrifier son expérience dans toute sa richesse existentielle pour parvenir à une certaine généralité. La sacrifier : c’est-à-dire faire l’effort d’aller au delà, ce qui n’implique pas pour celui qui écrit, pour celui qui pense, qu’il essaie de se masquer à lui-même ce qu’il éprouve — bien au contraire, il s’y abîme et en explore toutes les facettes —, mais il éprouve le besoin, précisément, d’en sortir, d’en émerger de façon à tenir une parole (en parvenant à une idée, à un concept plus général) qui le tire de sa condition particulière pour le faire advenir à sa condition d’être humain. Il transmue ainsi son expérience particulière en une expérience qui aurait une valeur humaine générale et, de la sorte, parvient à se libérer de cette expérience particulière, ou de ce que cette expérience particulière comporte de souffrant. Il y a dans ce genre d’écriture, de pratique, une certaine forme decatharsis, que le lecteur doit sentir et à laquelle il est appelé à participer à partir de sa propre expérience. Donc, une telle écriture exige du lecteur qu’il n’en reste pas à l’approche théorique ou à une pure réception intellectuelle de ce qu’il lit. Elle implique que le lecteur fasse l’effort de retourner à sa propre expérience à partir du concept ou de la réflexion avec lesquels il vient d’entrer en relation et, faisant retour sur sa propre expérience, qu’il puisse à son tour continuer la réflexion avec laquelle il est entré en rapport. C’est une considération qui m’apparaît très importante quant à la manière de lire mes livres. Je pense que trop souvent on s’attend à ce qu’un livre qui se présente comme un ouvrage théorique livre tout de suite son « idée principale », son « message central », alors qu’en réalité, l’écriture telle que je la pratique fait toujours appel au lecteur, à son expérience et à sa réflexion propres. C’est à partir du moment où le lecteur consent à faire retour sur sa propre expérience, tout en poursuivant la lecture de l’ouvrage, qu’il peut véritablement en comprendre les résonances et les diverses implications. Autrement, je pense qu’il passe à côté de l’essentiel et qu’il butera sur une difficulté de compréhension.
S. N. — Votre conception de la philosophie liquide-t-elle l’idée généralement admise de la philosophie entendue comme quête du vrai et de l’universel ? Ou alors la philosophie devient-elle une « version signée du Vrai », selon une formule que vous utilisez dans Créer un monde (p. 185) ? Quelle différence y-a-t-il entre une « version signée du Vrai » et une « Version unique du Vrai » ?
M. M. — La question principalement en jeu dans ce que vous soulevez, c’est d’abord celle de la vérité et on ne peut pas éviter de se demander : qu’est-ce que la vérité ? On ne peut non plus éviter de rester relativement circonspect, voire muet devant une telle question. Qu’est-ce que la vérité ? Je ne prétendrais pas y répondre. Est-il possible d’écrire, notamment d’écrire avec une visée universelle, généralisatrice, sans être animé par un certain souci de la vérité ? Je pense que non… La question de la vérité s’en trouve-t-elle pour autant éclairée ? Je l’ignore… On fait souvent la distinction entre authenticité et vérité. Qu’il y ait dans ce que j’écris et, de façon plus générale, dans la philosophie un souci d’authenticité, je ne crois pas qu’on puisse le nier. Par souci d’authenticité j’entends le souci de se délivrer le plus possible des faux-fuyants, des masques, des représentations, de tout ce qui peut faire obstacle à une certaine forme de vérité intérieure qui cherche à s’exprimer. Quand je parle de « vérité intérieure », je pense que je renvoie à ce que je disais tout à l’heure : à la relation que chacun peut percevoir, de l’intérieur de ce qu’il éprouve et de ce qu’il pense, à ce qu’il y a là d’irréductible, c’est-à-dire ne pouvant être ramené à rien d’autre. C’est cet irréductible qui exige d’être dit, qui exige d’être signifié. Le noyau, en tant qu’il est saisi, dit et formulé, a nécessairement valeur universelle. Il peut être repris, selon une modalité particulière, par n’importe quel lecteur qui entrera en relation avec lui. Mais il va sans dire que le rapport entretenu par chacun à ce que j’appelle ce noyau (qu’on pourrait aussi appeler l’« essence », selon un terme plus classique en philosophie) est évidemment différent, nécessairement différent. Il existe donc plusieurs versions du rapport à ce noyau, du rapport à cette essence. Celui qui écrit, à travers d’abord la manière dont il écrit, c’est-à-dire son style, présente une version qui s’adresse à quelqu’un d’autre, avec la visée que cet autre parvienne aussi à son tour à produire sa version, laquelle peut engendrer une autre version. Ceci n’est pas dit au sens où toutes les versions se vaudraient, au sens où elles graviteraient autour de rien, où tout ce qui peut s’exprimer, selon un certain relativisme, aurait une valeur égale. Toutes les versions se valent dans la mesure où elles sont versions d’un noyau qu’on cherche à approcher ou d’une « essence » qu’on cherche à approcher. Dans la mesure où cet effort est fourni, je pense qu’on peut dire que toutes les versions se valent. Et à ce moment-là, si l’on tombe dans une certaine forme de relativisme ou de perspectivisme, c’est un relativisme ou un perspectivisme qui implique une relation à ce qu’on peut bien appeler « vérité », dont on peut dire que, quoiqu’on n’y parvienne jamais définitivement, si elle est évacuée du langage et de l’effort de signifier, le langage et l’effort de signifier s’effondrent.
S. N. — Vous écrivez dans Créer un monde « que le philosophe est accoucheur de lui-même comme singularité. » (p. 64) Ceci me semble une idée assez singulière… Pouvez-vous éclaircir ce propos ?
M. M. — Votre question est intéressante dans la mesure où elle m’amène à me demander quelle est, de ce point de vue, la différence entre une œuvre qu’on pourra dire philosophique et une œuvre artistique ou une œuvre littéraire. Est-ce que l’artiste n’essaie pas d’accoucher de sa singularité, quiconque se donne à une œuvre n’essaie-t-il pas d’accoucher de sa singularité ? Certes ! De ce point de vue, je pense qu’il n’y a pas vraiment de privilège du philosophe. Je pense que la seule singularité de cette expression consiste précisément à l’appliquer au philosophe, contrairement à la manière dont la philosophie est généralement approchée. En d’autres termes, si je me suis donné la peine d’écrire une telle formule qui vaut pour quiconque s’adonne à une œuvre, c’est que la plupart du temps, étant donné la conception a priori universaliste et théorique qu’on se fait de la philosophie, on ne s’imagine pas et parfois on ne soupçonne même pas qu’une singularité tente d’accoucher d’elle-même, tente de se produire à travers cette œuvre de philosophie. Ceci est un présupposé de toute mon œuvre et, du même coup, de ma conception de la philosophie : la philosophie prend son sens dans la mesure où, à travers l’œuvre, une singularité tente d’accoucher d’elle-même. Mais, contradictoirement, comme je l’ai dit au début de notre entretien, la plupart du temps, cette singularité ne parlera jamais d’elle-même, sauf d’une façon tout à fait secondaire et relative. Au contraire, elle tendra vers des propositions à valeur générale et universelle. Il y a là une contradiction et il m’est toujours paru extrêmement important d’affirmer cette contradiction. Il est bien évident qu’à partir d’auteurs comme ceux que vous citiez au début (Kierkegaard, Nietzsche, Pascal… mais aussi saint Augustin, par exemple) la tension contradictoire entre l’effort du concept, l’effort de la réflexion universelle, et l’expérience particulière est souvent exprimée, à l’intérieur même de ce qui est écrit, mais surtout à travers une écriture et un style qui témoignent de cet effort et de cette tension. Souvent s’agit-il encore d’une écriture qui se trouve fragmentée, comme on le voit chez Pascal ou chez Nietzsche, qui porte ainsi la trace de l’effort que le penseur tente de faire pour porter à l’universalité son expérience particulière.
Il est beaucoup de philosophes toutefois, et on pourrait dire qu’ils constituent la très nette majorité dans notre tradition philosophique, qui s’évertuent à dissimuler qu’il soit question de leur propre singularité à travers leur œuvre. Je ne pense pas que ce soit le cas par exemple chez un penseur comme Platon ou comme Descartes : le dialogue philosophique chez Platon est une mise en situation, une mise en écriture d’une singularité qui trouve probablement à s’exprimer à travers le personnage de Socrate et de ses interlocuteurs, dialogue qui renvoie toujours au fond au dialogue qu’entretient Platon avec lui-même ; Descartes fait lui-même état de sa propre expérience, particulièrement dans le Discours de la méthode et dans beaucoup de ses Lettres. Chez des penseurs comme ceux-là, on voit, on peut deviner la trajectoire. Mais il est des penseurs qui s’évertuent à cacher cette trajectoire et qui vont même jusqu’à considérer que faire état d’une telle trajectoire aurait quelque chose d’indécent ou de honteux, de telle sorte que leur œuvre se présente comme une pure œuvre de connaissance. Mais si l’œuvre philosophique est une pure œuvre de connaissance, qu’est-ce donc qui la distinguera d’une œuvre purement scientifique ? Car il y a une distinction, n’est-ce pas ? Et s’il y a une distinction, je pense qu’elle est là où l’on essaie de pointer, c’est-à-dire dans le sens où une singularité est en jeu à travers ce qui s’écrit. Même chez un penseur que j’ai longtemps pratiqué comme Spinoza dont L’Éthique est un modèle d’écriture extraordinairement théorique, quand on entre à l’intérieur de cette pensée, l’on est amené à retrouver la trace d’une singularité qui essaie de se penser à travers ce mode d’écriture extrêmement théorique. Toutes les propositions s’enchaînent dans L’Éthique, mais, comme le faisait remarquer Deleuze, elles n’ont pas nécessairement été écrites dans l’ordre sous lequel elles se présentent. On peut supposer au contraire qu’elles auraient été écrites à la faveur d’un certain désordre et que Spinoza les aurait progressivement rattachées les unes aux autres, — peut-être pour mieux dissimuler les hésitations et les failles qui se cachent de l’une à l’autre. Mais je pense que même à travers une écriture comme celle-là, la trace d’une singularité peut être repérée. En fait, c’est toujours dans l’écriture qu’elle est repérée.
S. N. — Je vais maintenant vous poser une question quelque peu étrange : je me demandais si, sans rien enlever à la portée proprement idéelle ou théorique de vos essais, il n’était pas possible de les lire un peu comme des romans, où il s’agirait non pas tant de suivre le destin de tel ou tel personnage, comme dans un vrai roman, que de suivre le destin de telle ou telle idée, l’aventure de la pensée (avec ses rebondissements) prenant en quelque sorte le relais de l’aventure romanesque (avec son intrigue traditionnelle).
M. M. — Faisant retour sur l’ensemble des livres que j’avais pu écrire, je me suis déjà rappelé la façon dont Balzac était parvenu à découvrir qu’il était en train d’écrire La comédie humaine. Il avait déjà beaucoup écrit et publié lorsqu’il s’est rendu compte que certains liens pouvaient être faits entre tous ses livres, que certains personnages revenaient, qu’il pouvait donc faire l’effort peut-être plus conscient maintenant de les faire revenir dans telle ou telle autre situation, de relier ce qui au départ n’était pas véritablement relié pour qu’une idée s’en dégage et par conséquent une unité. Faisant retour sur ce que j’ai écrit, je suis amené à me rendre compte que, non pas, comme vous le dites, à travers des « personnages » — puisque mes œuvres ne sont pas des œuvres de fiction — mais à travers des idées ou des mouvements d’idées, une certaine manière de poser les problèmes trouvait des échos d’un livre à l’autre, à la faveur de questions souvent fort différentes. Cette manière de poser les problèmes trouve des échos dans la mesure où, d’un livre à l’autre, en effet, comme on vient de le dire, une singularité tente de se produire,— sans savoir évidemment au départ ce qu’elle est en train de produire ni où elle s’en va exactement. Elle le découvre progressivement, et, avec le temps, elle jette une lumière sur des aspects au départ plus obscurs, revient sur certains autres pour les éclairer sous un jour nouveau. De la sorte, on pourrait dire en effet qu’à travers toute cette œuvre c’est l’histoire d’une conscience qui est en jeu, qui essaie de se faire, de s’écrire à travers les diverses idées qu’elle prend d’elle-même, des choses, de la réalité, et ainsi de suite.
Cette question renvoie aussi au mode de lecture de l’œuvre dont nous parlions plus tôt. Entrant en relation avec une œuvre qu’on dit ou qui se dit elle-même philosophique, le lecteur s’attend à ce que chaque ouvrage, chaque essai porte sur un objet déterminé auquel il apportera un certain éclairage, à propos duquel certaines questions seront débattues, développées en vue d’une conclusion, c’est-à-dire d’une thèse à affirmer. Ce n’est pas la façon dont il faut lire mes livres. Chaque livre est différent, non seulement par son objet, mais d’abord par son écriture, à tel point que de plusieurs ouvrages, peut-être la plupart d’entre eux, il est difficile d’arriver à dire quel en est exactement l’objet. Certes, on peut arriver à mettre à jour une certaine configuration de problèmes autour de certaines questions, mais il en va de cette démarche de pensée que chaque question soit toujours abordée indirectement, ou de biais, ou en relation avec d’autres, et non pas de manière à se trouver épuisée au terme de l’essai au profit d’une thèse qu’on aurait voulu affirmer ou qu’on serait parvenu à démontrer. Comme ce qui distingue chacun de mes ouvrages est d’abord une certaine forme d’écriture et diverses configurations de problèmes, la question qui se pose est de savoir ce qui les relie, ou ce qui, finalement, unit de tels ouvrages — question que j’ai été amené à me poser moi-même. Qu’est-ce qui réunit par exemple des livres aussi différents que Les pôles en fusion (dans lequel une expérience au fond très intime est en jeu qui va s’exprimer à travers une écriture assez diversifiée, une écriture parfois dialoguée, parfois très proche de la fiction ou encore d’une forme de journal intime), Le territoire imaginaire de la culture(un écrit beaucoup plus théorique dont l’enjeu est d’abord culturel et politique) et L’étrangeté de la raison (un écrit aussi plus théorique dont l’enjeu cette fois est plus directement philosophique) ? À cette question, il n’est pas moyen de répondre autrement que de la manière suivante : l’auteur, comme on vient de le dire, essaie de produire sa singularité, certes, mais il la produit en tentant de la penser de l’intérieur de divers contextes : qu’il s’agisse par exemple du contexte culturel et politique de sa société d’appartenance, en l’occurrence le Canada français (ou le Québec), qu’il s’agisse du contexte encore plus général de la tradition philosophique, comme dans L’étrangeté de la raison ou Créer un monde, ou même qu’il s’agisse du contexte de sa vie la plus personnelle, dans ses rapports aux autres, dans le rapport à son désir, etc. Le fil conducteur de tout cela serait donc une sorte de mise en jeu de soi dans des situations données d’existence (situations qui, en fait, sont celles dans lesquelles n’importe quel être humain est amené à se trouver, qu’elles soient de nature politique, intime, culturelle, philosophique, spirituelle ou artistique), et, de l’intérieur de ces situations, une singularité essaierait d’émerger de façon personnelle, essaierait de produire une parole, une pensée qui soient personnelles. Il s’agirait en fait d’une mise en jeu de soi qui serait appelée à être réfléchie, à être transposée en idées et en concepts. Comme on ne sait jamais si on va parvenir ou non à former une configuration qui se tienne, qui ait une cohérence suffisante (je ne sais pas si on peut parler de vérité), il y a nécessairement une « intrigue », et comme on se lance parfois dans des problèmes extrêmement difficiles, que ce soient ceux de la tradition métaphysique, ceux qui impliquent de penser le politique, on ne sait jamais si on va y parvenir. C’est en ce sens qu’on peut parler d’une intrigue qui traverserait l’œuvre entière. Le lecteur qui entre en relation avec une telle œuvre entre aussi en relation avec lui-même en tant qu’il est amené à faire lui aussi l’effort de penser sa propre existence. Chacun est un personnage sur la scène du monde qui a à produire ce qu’il est et l’auteur des livres qui sont les miens est l’un de ces personnages qui essaie de se produire et qui en appelle d’autres à se produire.
S. N. — J’ai remarqué qu’il y avait aussi quelque chose de très combatif dans vos essais. Si, comme vous le dites, vous tentez de vous produire comme singularité réflexive dans vos livres, vous êtes toujours aussi en train de faire la guerre, de vous livrer, d’une façon ou d’une autre, à un combat idéel. En ce sens, vos essais philosophiques ne sont-ils pas aussi de subtiles machines de guerre ? Et si c’était le cas, au nom de quoi faites-vous la guerre ?
M. M. — Je pense que la fin de la réponse à votre précédente question ouvre la porte à répondre à celle-ci. Je dis : voilà une œuvre à l’intérieur de laquelle il y a au fond un personnage principal, ce personnage principal est nécessairement l’auteur, inévitablement, puisque c’est lui qui est véritablement en jeu d’abord. Pourquoi essaie-t-il de se produire comme personnage ? D’abord parce que ça répond à une exigence irréductible en lui. En d’autres mots, il ne peut se contenter de traverser cette existence comme une ombre inconsistante… On peut peut-être trouver cela présomptueux, peu importe, il a besoin de se produire comme personnage à l’intérieur même de ce qui constitue l’histoire humaine, ou cette configuration très vaste qu’on appelle l’histoire humaine et qui a des résonances dans divers domaines d’expérience. Donc, c’est à une espèce de réveil de lui-même qu’il s’essaie sans cesse pour éviter d’être aspiré ou absorbé par ce qu’on pourrait appeler le « ce qui va de soi » : les représentations admises, les idées toutes faites, et cela dans tous les domaines (qu’il s’agisse du domaine intime, politique, de la manière d’écrire ou de penser la philosophie). Il répond à l’exigence de ne pas s’en remettre aux représentations toutes faites ni aux idées reçues, donc à celle d’essayer de produire sa propre réalité de l’intérieur de toutes ces représentations qui bien sûr l’affectent, l’assiègent, l’obnubilent. À partir de là, je pense qu’on a la direction pour répondre à votre question. La guerre est à mener contre ce qui sans cesse nous assiège et nous obnubile de manière à nous empêcher comme personne de nous réaliser d’une façon intégrale, de manière à nous empêcher de nous produire comme singularité unique et vivante qui se pense elle-même non seulement dans son intimité mais dans des contextes plus larges, qui pense ce qu’elle est et ce qu’elle a à penser relativement à la question de la philosophie, à la question politique, aux questions artistiques, etc… Il est évident que celui qui se livre à un tel effort se trouve dans un état de guerre perpétuelle, il a sans cesse évidemment à se battre contre ce qui tente de le réduire. Or, les sociétés humaines sont constituées de telle manière qu’elles tentent toujours de réaliser un consensus autour de valeurs collectives, d’entités abstraites, d’idéologies. Donc, les sociétés humaines sont vouées en quelque sorte à réduire les individus pour en faire des unités de fonctionnement à l’intérieur même de la société. Voilà ce à quoi s’oppose mon œuvre de la première à la dernière ligne. C’est à cette réduction de l’entité individuelle à une unité parmi d’autres à laquelle toutes les sociétés humaines se vouent qu’une résistance constante est opposée. D’où la guerre, guerre relativement à certaines questions politiques, par exemple, notamment toutes celles qui cherchent à enfermer l’individu dans des représentations identitaires ou encore dans des idéologies.
Le contrat d’inversion, mon premier ouvrage, s’ouvre sur une guerre, la guerre menée contre l’idéologie socialo-marxiste par laquelle j’ai été moi-même atteint, ce n’est donc pas une lutte gratuite ni abstraite, c’est la guerre que je mène pour m’en libérer. Et mon œuvre commence à travers cette guerre-là. J’ai aussi mené une guerre pour me libérer de la tutelle de l’idéologie nationaliste, particulièrement puissante au Québec comme vous le savez, et qui tend à occuper tout le champ de la culture. Dans les années 1975, je me suis retrouvé dans un contexte où l’idéologie nationaliste s’est mise à prendre de plus en plus d’importance dans la société québécoise avec la visée de l’indépendance, le tout accompagné d’une sorte d’unanimisme obligatoire des intellectuels autour de la question nationale dans le sens d’une adhésion à l’indépendance. J’y ai vu là un extrême danger, celui de la réduction de l’individu, de cet individu qui, dans le cadre de la société québécoise, s’était déjà trouvé pendant très longtemps réduit à travers l’institution religieuse notamment et qui avait commencé de s’émanciper dans les années 60, 70. Or, voilà que se mettait en place un mouvement qui à nouveau tentait de le réduire et de le ramener sous la tutelle d’une idéologie ! Il était particulièrement inquiétant de constater que la quasi totalité des intellectuels à l’époque se rangeaient derrière ce projet et supportaient extrêmement mal, c’est le moins qu’on puisse dire, que la moindre dissidence dans le monde intellectuel et artistique en particulier puisse s’exprimer. Voilà un exemple d’une guerre que j’ai toujours menée depuis, jusqu’à mon dernier livre dans cette veine, L’identité fuyante, et les textes que j’ai publiés dernièrement dans la revue Liberté (« La grande arnaque », « Ex-patriation »). Cette option anti-nationaliste qui revient dans mon œuvre est une option qui se comprend du point de vue que nous venons de dégager précédemment qui est celui de la production d’une singularité libre.
Il est évident que le combat est à mener sans cesse, par l’auteur lui-même, en tant qu’il cherche à se produire, mais qu’il est aussi à mener sans cesse (n’oublions pas que je suis aussi professeur, c’est-à-dire pédagogue) pour que d’autres singularités arrivent à se produire. Et c’est là l’enjeu, je dirais, de la publication de mes écrits, puisque s’il ne s’agissait que de me produire moi-même peut-être qu’à la rigueur je pourrais les laisser cachés. Mais si on les publie, évidemment, ils s’adressent à d’autres. Et qu’est-ce qui est visé chez l’autre ? Ce réveil de la conscience qui lui permettra à son tour de mener le plus librement possible sa destinée, en étant indépendant et fier d’être indépendant à l’égard des préjugés, des idées toutes faites, des idéologies et de toutes les tentatives auxquelles s’essaie sans cesse une société pour réduire un individu. Je pense que c’est là l’enjeu de mon œuvre, l’enjeu existentiel, philosophique et politique. D’où la guerre à mener, qui ne cessera vraisemblablement jamais.
Retour en haut de page ![]()
L’aventure d’une conscience : 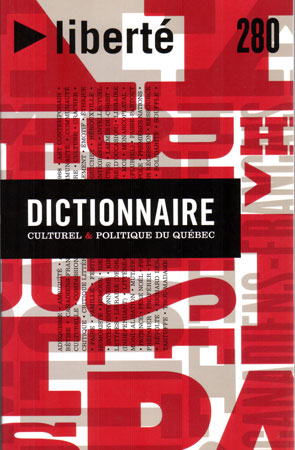
2e partie, suite de l’entretien, no 280
Simon Nadeau, (1re partie) no 279, février 2008, p. 102-115 et (2e partie) no 280, avril 2008, p. 73-84.
II. Luttes à mener dans le cadre de la civilisation actuelle et leur enjeu :
Le murmure signifiant
S. N. — L’aspect combatif de votre pensée est aussi très présent dans votre dernier livre, Le murmure signifiant. Toutefois, ici, comme dans vos livres Vertige ! ou Désert, ce n’est pas tant le nationalisme qui est visé que la civilisation contemporaine dans son ensemble. Quelle est la nature de ce combat ? Que combattez-vous dans la civilisation actuelle ?
M. M. — Je pense qu’il y a deux directions dans lesquelles le combat doit s’engager et être mené dans l’optique d’une émancipation véritable de l’individu dans la société moderne. La première direction de ce combat concerne ce qu’on pourrait appeler les « forces réactives » qui tentent toutes de nous ramener à un état antérieur à la modernité qui serait préférable à ce que celle-ci signifie. Qu’est-ce que celle-ci signifie, essentiellement ? De mon point de vue, ce que la modernité signifie, c’est l’avènement d’un sujet qui pense par lui-même comme déjà cela se trouve annoncé et pensé par Descartes, l’avènement d’un individu émancipé des liens familiaux, nationaux, religieux, de tous ces liens qui pouvaient le prédéterminer, le prendre en charge dès sa naissance, de telle sorte qu’il n’ait pas à suivre le chemin de lui-même, à s’assumer et à produire sa propre existence. Or, plus se développe cet effort de la Modernité qui va nécessairement dans le sens de la dissolution des solidarités anciennes et ataviques, plus se mettent en place des forces réactives (qu’on pourrait comprendre sous le nom général d’« intégrisme »). Les manifestations d’intégrisme sont aujourd’hui devenues nombreuses, répandues, dans certains cas elles se sont emparées des États, et je pense que de manière générale l’effort du nationalisme, où que ce soit (y compris au Québec), va dans le sens de mettre l’État au service de cette puissance de réaction, faire de l’État lui-même un agent au service de cette puissance de réaction. Le combat doit donc être mené en ce sens contre les forces de réaction. Je pense que c’est ce qui est en question dans des livres comme Le territoire imaginaire de la culture, Souveraineté de l’individu,L’identité fuyante où le nationalisme (particulièrement dans sa manifestation québécoise) se trouve visé. Mais c’est aussi le cas d’un livre comme Mort et résurrection de la loi morale dans lequel il n’est de façon directe jamais véritablement question du Québec, mais où se trouve fourni un effort pour démonter la logique intégriste à sa source même et dans ses divers mécanismes, quelle que soit la manière dont elle s’applique. Étrangement, c’est à partir d’une œuvre fort ancienne que ce démontage est mis en œuvre, en l’occurrence l’Orestie d’Eschyle. Voilà ce qu’il en est de la première direction dans laquelle le combat doit s’engager et se mener.
Deuxième direction : celle que vous venez d’indiquer dans votre question qui concerne la manière même dont les sociétés modernes arrivent à se produire et à se développer. Or, s’il est une vertu des sociétés modernes que je viens de souligner, celle de favoriser de manière générale l’émancipation de l’individu, il se met aussi en place dans ces sociétés modernes un mécanisme de prise en charge de l’individu. Celui-ci fonctionne assez différemment de celui qu’on peut observer du côté des forces de réaction ou de l’intégrisme. Là aussi cependant, dans le sillage même de l’effort que font les sociétés modernes pour s’imposer et se développer, l’individu est redouté. On favorise son émancipation mais en même temps on met tout en œuvre pour la réduire, la contrôler et la canaliser dans un sens qui soit profitable à une certaine façon dont cette société se comprend. Or, si cette société se comprend comme fournissant un effort d’émancipation individuelle, elle se comprend aussi comme mettant en œuvre systématiquement une entreprise de production qui se trouve de plus en plus poussée à l’extrême, qui implique aussi évidemment une entreprise de consommation. On pourrait dire que tous les individus aujourd’hui sont conscrits, en quelque sorte mobilisés au profit de cette entreprise de production/consommation. Le problème n’est peut-être pas la production en tant que telle, puisque l’être humain doit se colleter à la matière, transformer la nature, mais le fait que la production devienne « productivisme », qu’elle ne sache donc s’imposer à elle-même aucune limite. Le moyen de développement de ce productivisme sans frein est incontestablement le développement technique. Or, le développement technique est devenu tel aujourd’hui qu’aucun individu pris en lui-même ne peut prétendre le maîtriser, ne peut même prétendre maîtriser les moyens techniques les plus élémentaires qu’il met en œuvre chaque jour. Les moyens techniques qui me paraissent le plus dangereux du point de vue de l’émancipation de l’individu sont incontestablement ceux qui affectent la puissance imaginante de l’individu de même que sa puissance proprement intellectuelle. Je pense évidemment tout particulièrement à l’essor considérable qu’ont pris à notre époque les techniques d’information et de communication, à l’essor considérable de ce que j’appellerais globalement les « machines à images » et les « machines à penser ». Il y a là un danger considérable au sens où l’individu (seul avec lui-même, capable d’imaginer, de désirer par lui-même) est pris en charge dès son plus jeune âge dans sa puissance imaginante elle-même, à travers notamment la télévision, un certain cinéma et de façon générale toutes les techniques de mise en images qui se développent aujourd’hui (photographie, ordinateur, etc.) Le danger étant que l’individu en vienne à perdre la notion même de sa puissance imaginante et risque d’en venir à croire (spécialement chez les jeunes) qu’il est impossible d’imaginer sans s’appuyer sur des images toutes faites et sur les « machines à images » qui les rendent possibles. De telle sorte qu’il en vient à faire confiance d’abord à ces machines et à ces images produites plutôt qu’à sa puissance personnelle et naturelle d’imaginer.
Si on considère que c’est à travers cette puissance personnelle d’imaginer que s’exprime le plus nettement la personnalité de l’individu, sa singularité la plus irréductible (il est le seul à imaginer ce qu’il imagine et à percevoir ce qu’il perçoit) et que cette puissance imaginative et perceptive est prise en charge dès son plus jeune âge par des machines auxquelles il fait confiance plus qu’à lui-même, il y a là un moyen de négation de la réalité individuelle et, à la longue, de destruction cette réalité. Et ce, au nom même de l’émancipation de l’individu puisque il est bien sûr dit libre de se procurer ces machines, d’en faire ce qu’il veut, de se commander à sa guise ce qu’il veut, comme si la pensée humaine, l’imagination humaine consistaient à se commander ce qu’on veut en appuyant sur des boutons selon le modèle de la télécommande ! Je mentionne à plusieurs reprises dans Le murmure signifiant que le mot d’ordre implicite de la civilisation moderne semblerait être : « Il n’y a rien à chercher ni à trouver à l’intérieur de soi. » Bref, il n’y a pas d’intériorité, l’intériorité est un mythe ! Tout est à chercher en dehors et tout a déjà été produit pour que l’individu trouve en dehors de lui-même de quoi satisfaire ses désirs, ses besoins, son imagination. Voilà un danger extraordinairement important à notre époque. Ce danger doit être envisagé véritablement pour ce qu’il est en se rendant compte de ceci : il n’y aucun moyen technique dont l’usage n’implique une mise à contribution de la vie intérieure d’une personne et qui n’implique des répercussions sensibles à l’intérieur de cette personne. Le présupposé du Murmure signifiant est que la conscience s’entend d’abord élémentairement à partir de la sensibilité, à partir de l’expérience sensible, de l’expérience perceptive la plus élémentaire. C’est son lieu même de naissance et de développement.
S. N. — La conscience humaine prendrait donc, selon vous, sa source dans l’expérience sensible, dans ce qu’on pourrait appeler l’intériorité de la sensibilité. Est-ce pour cette raison que vous appelez l’être humain dans Le murmure signifiant non pas l’«animal rationnel » mais le « sentant-percevant-pensant » ?
M. M. — Exactement. Je pense que c’est à partir de la conscience que l’individu est amené à prendre très lentement et progressivement de la nature même de sa perception et de son imagination (la manière qui lui est propre de percevoir et d’imaginer) que réside l’essentiel de sa singularité. Tel serait aussi mon présupposé : chaque individu est caractérisé par une manière qui lui est propre de percevoir et d’imaginer. Ce mot de « manière » correspond à la traduction du mot latin « modus » que l’on trouve chez Spinoza souvent traduit par « mode ». De ce point de vue en effet, chaque individu est un mode essentiellement sensible avant même d’être une intelligence plus ou moins formée ou une « raison ». C’est dans ce mode que sa singularité réside d’abord. Or, c’est précisément ce mode qui se trouve systématiquement détourné de lui-même et pris en charge par tous les moyens techniques qui se développent aujourd’hui. Et ce, à l’insu même de l’individu et en toute inconscience de sa part, inconscience d’ailleurs relayée par la plus grande partie des intellectuels qui ne se rendent pas compte de ce processus et continuent de proférer des propos intellectuels, de tenir des thèses rationnelles comme si l’intelligence ne prenait pas d’abord sa source dans la sensibilité et comme s’ils ne risquaient pas de plus en plus de s’adresser à des individus rigoureusement aliénés, d’une aliénation qui ne les empêchera pas toutefois de faire « fonctionner leur intelligence », leur rationalité, un peu comme un ordinateur en réalité…
Cette inconscience est étonnante, mais elle n’affecte pas les véritables artistes ou créateurs. C’est le sens de l’importance qui se trouve accordée dans Le murmure signifiant à la peinture et au cinéma, mais spécialement à ce que j’appelle la « peinture moderne » (qui commence avec les impressionnistes) et à un certain cinéma qui fait essentiellement appel à cette expérience sensible (donc très différent de ce qu’on appelle aujourd’hui le « cinéma-spectacle » devenu « production »). Qu’est-ce qui caractérise l’art moderne et ce cinéma ? Une attention extrême aux mouvements les plus infimes de la sensibilité, une attention de la conscience à ces mouvements et une tentative de transposer ces mouvements les plus infimes de la sensibilité à travers des formes, des couleurs, des images qui en rendent compte le plus adéquatement possible, tout en sachant très bien qu’on n’en rend jamais compte parfaitement. C’est pourquoi l’art moderne se donne toujours comme un art en quelque sorte inachevé, un art qui n’a pas de fin, qui ne peut pas s’achever dans une représentation toute faite qui rendrait compte du réel une fois pour toutes. Le réel est en mouvement. Pourquoi ? Parce que la sensibilité et la conscience sensible sont sans cesse en train de changer, la perception du réel ne peut donc jamais être la même. L’art tente de transposer cette perception absolument singulière du réel. De ce point de vue, ce que j’appelle l’art moderne et un certain cinéma sont des « écoles de sensibilité » en même temps que des « écoles d’authentiques libérations individuelles » comme il en existe peu.
Or, cet art est un art au fond très rare. Il s’est illustré à travers un certain nombre de peintres, mais aujourd’hui on peut se demander ce qu’il en reste. Le cinéma dont je parle est aussi un cinéma extrêmement rare qu’on étiquette généralement comme étant un cinéma d’auteurs qu’on distingue de l’autre cinéma. En effet, il y a deux cinémas : celui qui répond à l’industrie du cinéma et à son impératif de production et celui qui est fait par des individus qui sentent, qui cherchent et qui essaient d’exprimer quelque chose d’absolument singulier. Bien que ce dernier cinéma implique comme tout cinéma un rapport à la technique, il implique aussi une grande liberté par rapport aux techniques cinématographiques et une grande liberté par rapport à la caméra. Ce n’est pas le cinéaste qui est au service de la caméra mais la caméra qui est au service du cinéaste qui tente d’exprimer quelque chose qui puisse en quelque sorte réveiller les puissances sensibles des spectateurs (puisque c’est de cela qu’il est question dans cet art et dans l’art comme je le comprends : réveiller les puissances sensibles, réveiller la conscience que l’individu peut prendre de ses puissances sensible et imaginante de façon à en faire un individu plus original, plus singulier, plus conscient de lui-même et tendanciellement plus créateur).
S. N. — Par-delà cette critique radicale que l’on trouve dans Le murmure signifiant de l’idéologie productiviste et techniciste qui caractérise l’époque contemporaine, l’enjeu principal de ce livre n’est-il pas justement de réveiller les « puissances sensible et imaginante » de l’individu dont vous venez de parler, reprenant en quelque sorte sur le plan de la pensée le défi que lançait l’art moderne à la civilisation industrielle alors en plein développement ?
M. M. — Oui, c’en est l’enjeu principal. En d’autres termes, l’enjeu principal de ce livre est de favoriser l’éclosion la plus répandue possible d’individualités réellement émancipées, non pas abstraitement émancipées au sens des Droits de l’homme, non pas émancipées au sens d’être « libres de… » mais émancipées au sens d’être « libres pour… » (comme Nietzsche en fait la distinction), émancipées au sens d’être en train de produire sa propre existence, de faire advenir son propre monde, d’où le titre d’un de mes livres : Créer un monde. Je pense que « créer un monde » est le destin qui s’offre à chacun. On me dira bien sûr que tous ne sont pas capables d’un tel destin. Mais la démocratie, telle que je l’entends, consiste en ceci que chacun est appelé sans exception, indifféremment de sa condition sociale, de sa condition de classe, etc. Bien sûr, chacun ne répondra pas à cet appel, cela tient à la liberté de l’être humain, ou alors chacun y répondra ou pourra éventuellement tenter d’y répondre à des degrés différents, de façon différente. L’important néanmoins est que l’on favorise que le plus grand nombre puisse entendre cet « appel » et éventuellement y répondre. La démocratie au sens où je la comprends ne consiste donc pas à ce que le même régime s’impose à tous indifféremment de manière à faire autant d’individus semblables les uns aux autres, mais bien que la culture soit adressée à tous, en sachant très bien que chacun ne peut pas y répondre au même niveau ni de la même façon. Il faut donc viser les « meilleurs », non pas en présumant qu’il y en a qui sont déjà étiquetés comme étant meilleurs pour quelque raison que ce soit, mais en faisant en sorte que de tous ceux qui existent en viennent à se dégager naturellement les meilleurs. Qui est-ce que j’appelle les « meilleurs » ? J’appelle les meilleurs tout simplement ceux qui sont les plus créateurs dans quelque domaine que ce soit. J’ai donné l’exemple de l’art, mais il n’est pas le seul à donner. On pourrait bien sûr donner l’exemple de la science, mais aussi de toutes sortes d’activités quotidiennes en apparence tout à fait ordinaires qui manifestent pourtant une créativité individuelle. C’est à travers cette créativité que l’individu peut parvenir à donner un sens véritable à son existence, à faire en sorte que son passage sur terre n’aura pas été vain.
S. N. — Il s’agit en définitive du combat dont vous parlez dans Vertige ! entre ce que vous appelez un « individualisme de fond et créateur » et un « individualisme de masse ou individualisme d’image ».
M. M. — En effet, ce combat correspond très bien à ce que je viens d’expliquer.
III. L’amitié créatrice et la communauté politique
S. N. — Au fond, vous en venez toujours à parier sur l’individu, sur l’« Unique », comme dirait Kierkegaard. On pourrait croire que votre éthique et votre idéal sont purement solitaires. Pourtant, la question du rapport à l’autre est aussi très présente dans votre œuvre (qu’il s’agisse des livres qui mêlent l’intime au théorique, tels Le contrat d’inversion, Les pôles en fusion, L’ami-chien. Fragments d’une éthique de l’amitié ; ou des livres qui abordent le rapport au politique et à votre milieu culturel d’appartenance, tels Le territoire imaginaire de la culture,L’Amérique du Nord et la culture, Souveraineté de l’individu et L’identité fuyante). Pouvez-vous expliciter cette question du rapport à l’autre dans votre œuvre ?
M. M. — En un sens on pourrait dire que l’individu n’est jamais seul en même temps qu’on pourrait dire le contraire, qu’il est toujours seul essentiellement. Les deux comportent une vérité. Qu’il ne soit jamais seul tient à ceci que chacun est un membre de l’espèce humaine, solidaire des autres membres de l’espèce humaine. Qu’il le veuille ou non, chacun est né dans un milieu déterminé, appartient à une famille déterminée, est amené à éprouver dès son plus jeune âge des relations sociales qu’il n’a pas choisies d’éprouver, sur lesquelles il n’a aucune autorité. De ce point de vue, chacun d’entre nous, chaque être humain est un exemplaire de l’espèce humaine. D’un autre point de vue cependant, si l’on considère que l’être humain est caractérisé par l’éclosion de la conscience et l’effort de la conscience, chacun est seul à être conscient de ce qu’il éprouve et de ce qu’il pense au fond de lui-même, chacun est seul à prendre précisément conscience qu’il existe un fond de lui-même, qu’il existe une certaine forme d’intériorité irréductible aux autres qu’il essaiera toujours d’une manière ou d’une autre sa vie durant de leur communiquer en y parvenant plus ou moins selon les diverses personnes avec lesquelles il entrera en relation, selon les divers rapports dont il fera l’expérience. Or, l’enjeu du travail philosophique que je fais est précisément, comme nous l’avons souligné jusqu’à maintenant, de favoriser le plus possible l’éclosion de l’individu et le développement de la conscience de lui-même, de la conscience de ses ressources les plus profondes. Or, il ne peut le faire qu’à la faveur d’un certain retrait par rapport à l’existence sociale, d’une certaine expérience de la solitude dans laquelle il pourra apprendre à porter attention à ce qu’il en est de ses pensées, de ses états d’être ou états d’âme, voire de ses perceptions les plus infimes. Cette expérience est capitale et indispensable à la formation de l’individu.
Cependant, cette expérience implique du même coup que chacun soit amené à faire l’expérience de sa faiblesse, de son caractère démuni, de son insuffisance et de la difficulté qu’il a à se tenir par lui-même comme être conscient. D’où la recherche de l’« autre », qu’on pourrait aussi appeler l’« ami ». L’ami, c’est-à-dire cet autre choisi parmi tous les autres, élu, en quelque sorte, auquel je pourrai confier le plus authentiquement possible ce qu’il en est de ma quête intérieure, de ma souffrance intérieure et auquel je pourrai quelquefois abandonner ma faiblesse. Le rapport d’amitié, au sens où je l’entends, a un caractère quasi ontologique. L’autre est nécessaire pour faire en sorte que le rapport à cet « être profond » qui me distingue de tous les autres puisse advenir à ma conscience, non seulement y advenir mais s’y maintenir et se développer : prendre un essor. La conscience peut advenir solitairement, mais peut-elle se maintenir indéfiniment dans cet état ? Peut-elle connaître un essor dans cet état ? Vous me permettrez d’en douter fortement, quoique des exemples existent de créateurs dont ce fut plus ou moins le cas mais qui ont dû connaître une destinée tragique en raison de cette situation d’isolement de la conscience (je pense à Nietzsche par exemple, à Rimbaud et combien d’autres…) Cela dit, rien n’est moins sûr, rien n’est moins garanti que la rencontre, la découverte de cet ami dont je parle. Ce rapport pour moi est essentiel et des plus importants parce qu’il en va de la conscience et, plus précisément, de la conscience créatrice de l’individu qui est ce par quoi l’être humain se distingue. C’est donc accorder un privilège à un tel type de rapport relativement à ce qu’on appelle en général les rapports amoureux ou les rapports familiaux et tous les rapports sociaux quels qu’ils soient. Dans le cas de l’amitié, il s’agit d’un rapport essentiel d’élection dans lequel l’essor de la conscience se trouve être l’enjeu principal : non la reproduction de l’espèce, non d’abord le confort sentimental ou quelque bien-être de cet ordre-là, non le plaisir qu’il y a à se reconnaître dans des « pareils » ou des « semblables » et la sécurité qu’on y trouve. L’enjeu est bien plutôt l’exigence que l’on peut être amené à rencontrer, dont on peut faire l’expérience du sein du rapport à cet « autre » qui est en relation directe avec mon effort de conscience.
Si je peux me permettre une considération personnelle, j’aimerais faire remarquer que mes premiers ouvrages ont été écrits avec une autre personne, Claude Bertrand, avec qui, dès le départ, un tel rapport d’amitié créatrice a été créé. Je peux dire que l’essor de l’œuvre que j’ai été amené à développer depuis maintenant une trentaine d’années a pris sa source dans ce rapport d’amitié tout à fait exceptionnel qui eut pour effet, justement, de dégager la puissance créatrice de l’un et de l’autre et de faire en sorte que chacun se rende compte que c’était à travers un tel rapport qu’il allait pouvoir se réaliser. Je ne crois pas que j’aurais pu accéder au degré de conscience qui est le mien, je ne crois pas non plus que j’aurais pu le maintenir à travers le temps si je m’étais trouvé complètement seul. L’éclosion n’eût été que partielle. Le risque alors eût été celui que court toujours chacun d’entre nous d’être très tôt récupéré par une institution, un ensemble, un mouvement, un réseau, quoi que ce soit qui l’éloigne, le distrait de lui-même et de son œuvre essentielle.
S. N. — Ce n’est donc pas la communauté politique qui permet d’accoucher de soi-même comme singularité, mais l’ami ?
M. M. — Tout à fait. En ce qui concerne la communauté politique à laquelle vous faites allusion, le plus que j’en puisse dire serait ceci : la communauté politique qui me paraîtrait être la meilleure est celle qui serait la plus favorable à l’éclosion des singularités individuelles, celle qui favoriserait le plus possible la liberté individuelle sous toutes ses formes et qui permettrait à l’individu de se développer sous tous les aspects qui font de lui un être humain intégral. Toute cette question aurait sans doute besoin d’un développement en lui-même, mais je dois avouer que je ne me suis pas attardé à l’élaborer et il dépasse sans doute mes possibilités. Ce qui me paraît cependant évident est que toute communauté politique dominée par une idéologie collectiviste (qu’elle se dise nationaliste, socialiste, communiste, ou qu’elle soit animée par une sorte de productivisme aveugle, ou régie par une manière de penser reprise à son compte par l’État) me paraît nuisible du point de vue de l’émancipation de l’individu et me paraît devoir être combattue de manière à faire en sorte que s’agrandisse le plus possible l’espace de liberté à l’intérieur de la société. Évidemment, le degré de domination de telle idéologie est fort variable d’une société à l’autre et chacun doit dans la société où il vit faire l’expérience du degré de liberté qui lui est rendu possible par la société et travailler de façon acharnée à l’élargir et à faire en sorte que le plus grand nombre possible d’individus y participent.
S. N. — En écrivant et en publiant des livres de philosophie, par exemple ?
M. M. — Par exemple, mais aussi en enseignant, ce qui me paraît tout aussi important sinon plus important. L’activité d’enseignement, d’éducation, à l’intérieur d’une société est primordiale, et je pense que ceux qui s’y livrent doivent avoir conscience de l’extrême importance de l’activité à laquelle ils se livrent. Éveiller la conscience (le plus possible et sous tous ses aspects), c’est précisément ce qui est en jeu dans l’éducation. Aucune discipline d’enseignement n’est exempte de ce travail : qu’on enseigne les mathématiques, la physique, la littérature ou la philosophie, la conscience est en jeu dans toutes ces disciplines et le professeur doit sans cesse l’avoir à l’esprit. Je pense qu’un tel travail dans une société qui tend vers la liberté, dans une société authentiquement démocratique, est fondamental et se trouve être à la base de toute démocratie authentique au sens où le savoir, la connaissance, l’effort de conscience sont rendus accessibles à tous ou du moins à la majorité, ce que l’État peut rendre possible. Mais le professeur a une responsabilité qui lui échoit à lui en tant qu’individu absolument unique, celle d’éveiller la conscience de la personne à laquelle il s’adresse de façon à ce qu’elle devienne une personne au sens le plus intégral du terme.
Retour en haut de page ![]()
